Au professeur/docteur qui se cache derrière son diplôme...le théâtre ne te reconnaît pas !
- Taoufik Jebali

- Apr 14, 2025
- 10 min read
Updated: May 9, 2025
Toi, ou toi, cher professeur ou docteur, toi qui es frappé saisonnièrement par des crises d'épilepsie et un gonflement de l'ego, et qui mènes des campagnes de haine abominables contre ceux qui ont accompli, innové et réussi, au lieu de regarder ton échec et ta perte. Si tu penses que le diplôme académique dont tu te vantes de manière grotesque et avec un sarcasme maladroit te donne le droit de faire taire les autres, laisse-moi te rassurer : tu as été trompé par ceux qui t'ont enseigné!

Certains t'ont trompé en te faisant croire que tu faisais partie de l'"élite", et que les autres étaient des adversaires et des ignorants. Mais ils ont oublié de te dire que le théâtre est un art humain, qui ne se mesure ni par les diplômes ni par les distinctions, mais surtout par le contact, l'épreuve et l'impact profond sur les gens.
Et quelle tragédie pour toi ! Tu es coincé dans cet art - peut-être malgré toi – et te voilà en train de tenter de le monopoliser par le titre, et non par le talent...
Et pour ton information, cher Docteur, dans les sociétés qui apprécient la véritable créativité, le diplôme académique n'est pas toujours un passeport, mais plutôt un gage de renouvellement et d'innovation permanents. Dans le monde avancé, les titulaires de diplômes académiques sont soumis à une responsabilité permanente : celui qui ne produit pas, n'innove pas et ne renouvelle pas, même s'il détient les plus hauts grades, voit son titre devenir juste de l'encre sur du papier.
Cette vérité est ignorée par ceux qui s'appuient sur leurs diplômes comme pour marquer une supériorité illusoire, tandis qu'en réalité, ils cachent derrière eux l'incapacité, la paresse et la condamnation des autres, et tentent, en vain, de monopoliser des positions fragiles qui correspondent à leurs ambitions modestes.
Et dans les sociétés avancées, qui ne te ressemblent pas, cher professeur, la question "qui est habilité à enseigner?" ne se pose pas ; car la réponse est claire : il y a celui qui crée et qui laisse une empreinte et celui qui enseigne, sans laisser de traces.
Il n'y a pas de différence entre le professeur et le balayeur, si l'un d'eux n'apporte pas ce qui éveille la conscience. Le balayeur peut nous surprendre avec une philosophie vivante, et le professeur peut être juste un morceau de papier qui a obtenu un titre dans un moment de sommeil institutionnel.
Le théâtre ne s'enseigne pas comme on enseigne les règles de grammaire ou la physique. Et il ne peut pas être réduit à une série de références théoriques, importées par nos universités sans tri ni questionnement. La formation ne se réduit pas à des livres, et les références ne créent pas des visions. La véritable référence dans le théâtre est le corps qui a vécu, le souffle qui s'est étouffé et l'œil qui a vu.
Et même certaines de ces références que tu as apprises sans compréhension n'ont jamais été déterminées par des universitaires, mais c'est le contraire qui est vrai: les plus grands innovateurs de l'histoire du théâtre – de Stanislavski à Brecht, de Grotowski à Brook, et de Peter Brook à Anne Bogart – ne se sont pas nécessairement formés dans des universités, mais dans des laboratoires d'expérimentation, sur de petites scènes, et à travers des tests vivants qui les ont conduits à construire leurs théories, et non l'inverse.
Et parce que tu es enfermé dans ta tour d'ivoire académique en ruine, tu n'as pas remarqué ce qui se passe en dehors des murs : le temps a changé.
Aujourd'hui, la formation sur le terrain, celle qui se déroule dans de véritables ateliers, dans l'expérimentation, est devenue l'option la plus légitime et la plus répandue.
Dans le monde entier, les systèmes de formation sont révisés, et les parcours non conventionnels, les enseignants expérimentés, les rêveurs audacieux, ceux qui ont tracé leur propre chemin, sont mis à l'honneur, et non ceux qui ont suivi un chemin tracé à l'avance simplement parce qu'ils ont obtenu une approbation administrative. Ne rejettes pas l'échec sur les autres, mais réveille-toi, réfléchis et réexamine-toi de peur de disparaître.
Le moment présent place le théâtre tunisien aujourd'hui devant un choix historique : soit nous continuons à nous abriter derrière les institutions et le prestige académique dont les programmes et les méthodes d'enseignement n'ont pas été révisés depuis des décennies, produisant ainsi des cohortes de "théoriciens du théâtre", soit nous repensons radicalement les mécanismes de formation pour nous ouvrir sur ce qui se passe dans les ateliers, dans l'expérimentation, dans le contact direct avec la réalité. L'avenir ne se construit pas avec des diplômes, mais avec l'expérience.
En réponse à Fathi Akkari, entre autres
Permets-moi d'ouvrir discrètement la boîte de Pandore et de te rappeler que ton engagement envers la méthode scientifique et la précision n'était pas courant lors de la fondation du Centre des Arts Théâtraux (l'ancien Institut supérieur des arts dramatiques (ISAD), où toi et tes camarades de génération – comme Ezzeddine Gannoun, Ridha Boukadida, Hassen Mouathen, Rabiâ Ben Abdallah, Abdelmajid Jallouli, et bien d'autres – vous avez été formés par des personnes (moi y compris) sans expériences académiques ou diplômes élevés, et quelle horreur, à l'exception peut-être de deux personnes (Rached Mannai pour les marionnettes et Habib Massrouki pour le cinéma).
Votre formation à l'époque était un pur effort, une adaptation à l'inconnu et un test du possible. Et quand je relis aujourd'hui le programme fondamental, je souris à certaines de ses généralités méthodologiques et appliquées qui n'étaient que des débuts issus de cette époque.
La question essentielle ici est : comment votre génération a-t-elle réussi – malgré ces débuts modestes – à propulser cet art vers des horizons lointains, à produire une créativité marquante, et à proposer des alternatives intellectuelles et esthétiques distinctives, avec le "théâtre organique" comme exemple, tandis que les expériences ultérieures, malgré la possession d'outils plus avancés, n'ont pas pu atteindre le même impact ?
Aussi, lorsque vous avez été invités plus tard à transmettre votre expérience et à former les nouvelles générations, qu'avez-vous fait ? Dois-je être franc ? Vous avez renié vos origines "anti-institutionnelles" d'où vous êtes partis, et vous avez semé chez vos élèves une certitude fragile qu'ils sont la "génération choisie", les transformant en paons se pavanant avec des illusions de sélection.
Vous les avez trompés en leur faisant croire que le théâtre est un secret fermé dont les portes ne s'ouvrent qu'avec vos clés, que quiconque en dehors de vos institutions est un intrus, que toute idée que vous n'avez pas bénie est suspecte, que toute différence est une trahison, et que toute audace est une menace !
N'est-ce pas ce qui s'est passé ? N'as-tu pas répété – avec ton camarade, Ezzedine El-Abbasi – aux oreilles des étudiants que les œuvres de Jebali et de ses semblables "ne sont pas du théâtre", et que tout ce qui est en dehors de votre programme est "ubuesque"? Combien de courants artistiques créatifs avez-vous étouffés sous votre manteau, n'échappant que quelques fragments dont certains se sont enfuis eux-mêmes, tandis que d'autres sont tombés dans la machine des valeurs fausses et de la stérilité artistique.
Et le résultat ?
La maladie s'est aggravée, la culture de l'exclusion s'est enracinée, et des formes de condescendance ont fleuri, sacralisant les barrières entre "l'élite" et "la marge", transformant le dialogue en un conflit de légitimité.
Alors, quelle est la solution maintenant ?
Fermons-nous les yeux sur le passé ou le rappelons-nous pour le juger ? Pardonner ou se souvenir ? Mais comment traiter une blessure qui a grandi dans l'ombre jusqu'à devenir un arbre majestueux aux racines ramifiées ?
À propos de ce qu'on nomme "intrus"
Dans le tumulte de la fin de cette saison (ramadanesque, notamment) où les factions se disputent des rangs fragiles, s'appuyant sur des prétentions de supériorité, de force et de prépondérance, il convient de porter un regard attentif sur la réalité de cet art en général, que ce soit au théâtre ou dans l'audiovisuel, avec ceux qui se sont arrogés les titres de "légitimes" et "authentiques", comme si les arts étaient un héritage à transmettre et non une âme à créer !
Ceux qui se sont octroyés – simplement en possédant de fausses cartes dites professionnelles – le droit à l'originalité et à l'isolement, se laissant emporter par les illusions de "mérite" qu'ils ont tissées autour d'eux comme une toile d'araignée fragile, puis se sont empressés de qualifier tout comédien différent de "nouveau venu", "d’intrus", comme si la créativité était un registre commercial assiégé par l'ancienneté.
Mais la pratique sur le terrain de l'art dramatique révèle l'illusion de ces titres ainsi que de ces attributions collégiales : il y a une inventivité vivante qui respire en dehors des cadres périmés, tissant son langage avec les fils du talent, du savoir-faire et de l'humilité.
Une génération brisant les murs des tours d'ivoire, annonçant que l'art vrai ne naît pas dans les salles des institutions figées, mais dans le ventre de l'expérience libre. Ils sont peu nombreux à avoir échappé au fléau des traditions mortes, préservant leur singularité sans s'accrocher au fil de "l'égal au même" pourri.
L'absence d'examen de leur immobilisme, ceux qui parlent au nom du théâtre institutionnel, de leur fermeture et de leur incapacité à produire du neuf, ou même de reconnaître leur fausse légitimité, les empêche de voir les torches du renouveau portées par des comédiens différents dont l’art et l'action esthétique détruisent le temple de la stagnation.
L’art vrai ne se mesure point par le passé, même s'il brillait en son temps, mais par sa capacité à rendre compte du présent, à percer le siège de la prétention, du sacré, à émerger avec un corps vibrant luttant en permanence pour renaître et prendre vie.
Quand la différence est réprimée, l'imagination étouffée, c'est le signe, sans nul doute, que la culture primitive se propage de nouveau dans notre société, ne voyant dans l'autre qu'une menace : un adversaire, un ennemi, ou un "intrus" à mépriser, à exclure, ou — au mieux — à réduire à sa plus simple expression.
Une culture ne se construisant pas sur la convergence des expériences, mais sur le doute maladif, la classification rapide et l'hostilité envers quiconque ne ressemblant pas au troupeau. "Celui qui n'est pas avec nous... est nécessairement contre nous", dit-on.
Cette mentalité, rampante comme la moisissure, s'est infiltrée dans toutes les couches et institutions : du peuple aux élites, des médias à l'école, des espaces artistiques aux plus fragiles et contradictoires... le théâtre.
Le théâtre — cet espace censé être le laboratoire ultime de la liberté et de l'expérimentation — s'est transformé donc en un reflet oblitéré de cette médiocrité sociétale. La culture de l'hostilité y est non seulement pratiquée, mais légitimée, et se cache derrière un langage de spécialisation, de prétention à l'expertise, entre autres arguments factices.
C'est le règne donc des évaluations permanentes des uns par les autres. On trouve des candidats devant le temple du 4e art qui estiment que leur diplôme d'une grande école leur confère le "droit exclusif" d'évaluer les autres et de rabaisser tous ceux qui choisissent un parcours artistique libre, indépendant, non institutionnalisé. De fait, ceux qui n'appartiennent pas à leur système sont qualifiés d'"intrus", de "parasites" et d'"amateurs".
La même équation se répète : pas de production, pas de renouvellement, seulement des positions défendues avec un langage imprégné de vulgarité et de bassesse. Une violence symbolique flagrante, un mélange de moquerie bon marché et de sarcasme superficiel, dont le seul but est de détruire les expériences sérieuses qui ne leur ressemblent pas.
Ce qui est regrettable, c'est que la plupart d'entre eux n'ont réalisé dans leurs parcours que l'amplification de leurs ego fragiles et l'investissement dans l'illusion de la supériorité.
Le théâtre a été dépouillé de sa dimension libératrice. Avec cette mentalité, il est devenu une sorte de propriété personnelle, non un laboratoire collectif. Les "théoriciens du théâtre" ne reconnaissent que ceux qui leur sont dévoués et leur offrent un miroir confortable. Toute initiative sortant de leur carcan, du rang est exclue, toute voix différente est étouffée, toute pensée divergente est criminalisée.
Et ce qui se passe dans ce milieu n'est pas simplement une "jalousie professionnelle" passagère, mais un blocage culturel aigu, dirigé par une mentalité autoritaire déguisée, dissimulant la logique de la répression sous le nom de "goût" et distribuant la légitimité comme on distribue les privilèges : aux plus proches, aux plus obéissants et non aux plus méritants.
La société qui méprise la différence étouffe sa capacité à se renouveler. L'art qui ne s'ouvre pas à la pluralité se transforme en rites morts. Le théâtre qui n'ose pas reconnaître l'autre, perd son droit à la vie. N'est-il pas temps de nommer les choses par leur nom : ce système social, culturel, politique et économique ne protège pas le théâtre… il le tue à petit feu.
Ô toi, l'autodidacte opportuniste : le théâtre ne te reconnaît pas aussi
En effet, l'autodidaxie est un parcours noble lorsqu'elle est le fruit d'un effort, d'un apprentissage, d'une souffrance et d'une passion véritables. Mais ce n'est pas un prétexte pour la paresse ou la fausse prétention. Posséder la volonté ne t'exonère pas de la responsabilité d'être à la hauteur de ce que tu prétends, ni ne te donne le droit de prétendre être capable de former des acteurs si tu ne portes pas en toi-même une véritable compréhension de cet art.
Comment pourras-tu enseigner le théâtre si tu ne t'es pas formé toi-même ? Comment pourras-tu enseigner un art que tu penses encore être simplement des mouvements et des sons, sans décomposer et recomposer l'âme humaine dans une projection reflétant les transformations de la société et de sa culture ?
Il est vrai que chaque personne a le droit de tenter l'expérience, mais il y a une grande différence entre l'expérience personnelle et la prétention de pouvoir former les autres. Le théâtre ne se construit pas sur des règles naïves ou des techniques banales transmises comme des recettes toutes faites. La formation artistique n'est pas un atelier de bricolage, mais une plongée difficile dans la profondeur de l'individu.
Et le(a) véritable maître de théâtre ne donne pas de conseils rapides ou d'exercices mémorisés, mais plante la graine de la compréhension et guide l'acteur vers une conscience intérieure qui interagit avec le monde qui l'entoure. Le pire, c'est de transformer le théâtre en une marchandise vendue à crédit.
Exploiter la célébrité passagère ou se laisser entraîner par le rythme rapide des réseaux dits "sociaux" a créé une demande artificielle pour des "cours de théâtre rapides" qui commercialisent l'illusion et vident l'art de son essence. Quant à ceux qui voient dans ce phénomène une opportunité de profit facile, ils ne sont que des escrocs portant des masques de culture, offrant au théâtre des corps qui se déplacent sans conscience, car ils n'ont jamais plongé dans les profondeurs de cette mer que l'on appelle "art".
Le théâtre est une résonance qui représente les préoccupations et les problèmes des acteurs sociaux, c'est pourquoi il ne peut être dissocié de son contexte culturel et civilisationnel. Un bon formateur ne se contente pas d'apprendre à l'acteur comment se déplacer sur scène, mais lui enseigne comment voir avec elle. Comment transformer la compréhension en présence, et la souffrance en une énergie artistique vivante.
Quant à ceux qui limitent la formation à des exercices mécaniques et des conseils simplistes, ils ne forment pas des acteurs, mais reproduisent des êtres théâtraux sans empreinte.
Le théâtre ne célèbre pas in fine les noms de ceux qui l'ont traversé furtivement ou l'ont exploité, mais il reste fidèle à ceux qui l'ont aimé sincèrement et respecté sa sacralité. Être un(e) maître de théâtre n'est pas un honneur formel, mais une responsabilité éthique, libre et cognitive. Cherches donc la connaissance, cher autodidacte, avant de demander les projecteurs, et travaille sur toi-même avant de prétendre être capable de développer les autres. Le monde ne se souviendra pas des opportunistes, mais il gardera en mémoire les noms de ceux qui ont offert au théâtre une nouvelle âme éclairant le chemin des générations futures.
Tribune de Taoufik Jebali pour que la formation au théâtre devienne une complémentarité et non une rivalité
traduite de l'arabe littéraire par Mohamed Ali Elhaou














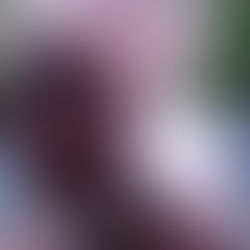


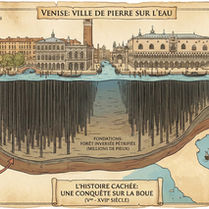
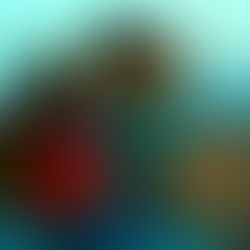

























Magnifique leçon !
Quelle tribune, vraiment bravo Si Taoufik